|
EN BREF
|
Les budgets verts émergent comme un outil crucial pour intégrer efficacement la biodiversité dans les politiques publiques. En analysant les atouts, les limites et les perspectives de cette approche, nous pouvons mieux comprendre comment orienter les financements vers des actions favorables à l’environnement. L’évaluation de l’impact environnemental des dépenses publiques offre un cadre pour appréhender les choix d’investissement et les arbitrages nécessaires, tout en tenant compte des enjeux contemporains liés à la protection de la nature. Dans ce contexte, il est essentiel d’explorer le potentiel de ces budgets pour contribuer à la sauvegarde de la biodiversité tout en répondant aux défis économiques et sociaux actuels.

Un modèle de co-construction
Une évaluation environnementale du budget a pour objectif de qualifier toutes les dépenses selon leurs effets sur l’environnement, en portant une attention particulière à leur contribution à la lutte contre le changement climatique ainsi qu’à la préservation de la biodiversité. Cette évaluation permet de faire le lien entre les dépenses engagées et des objectifs environnementaux définis au préalable. Par exemple, la France s’est illustrée comme un modèle avec la mise en place du premier « budget vert » en 2019, qui évalue la compatibilité du budget national avec des cibles environnementales. Ce modèle a été conçu pour aligner les dépenses, qu’elles soient budgétaires ou fiscales, avec les exigences de la taxonomie européenne. Cependant, il est essentiel de noter que d’autres acteurs, notamment les collectivités territoriales, jouent un rôle crucial dans cette transition écologique, grâce à leurs compétences variées.
Dans un cadre de co-construction, I4CE a développé, entre 2019 et 2020, une méthodologie pour évaluer les budgets des villes et métropoles en matière de climat, élargie ensuite aux Régions et à la biodiversité. Ce travail a impliqué plusieurs Régions et partenaires qui ont analysé les dépenses en les classifiant selon leur impact sur la biodiversité, selon les pressions identifiées par l’IPBES. Les résultats de ces travaux ont démontré que les budgets verts contribuent à sensibiliser les élus aux enjeux environnementaux, à intégrer ces considérations dans les directions financières et à orienter les discussions publiques sur les réorientations budgétaires au fil du temps.
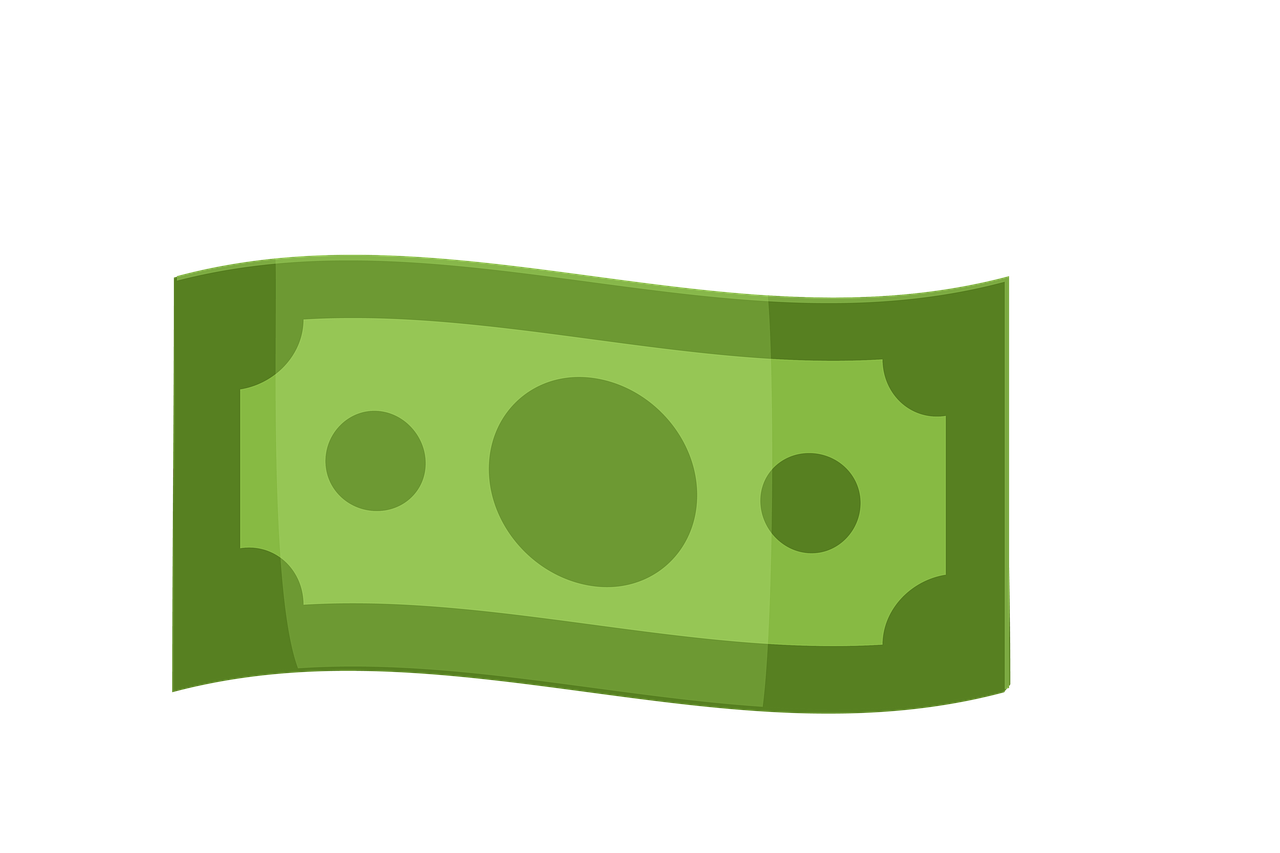
Budgets verts : défis et avenues pour la biodiversité
Les budgets verts jouent un rôle crucial dans l’intégration des enjeux environnementaux au sein des politiques publiques. Ils permettent d’évaluer la compatibilité des dépenses publiques avec des objectifs environnementaux préétablis, en analysant leur impact sur la biodiversité et l’atténuation du changement climatique. En 2019, la France s’est positionnée comme un leader mondial en introduisant le premier « budget vert », qui a permis d’établir un lien direct entre les dépenses budgétaires et la taxonomie européenne. Seules les collectivités de plus de 3500 habitants sont tenues par la loi de réaliser des analyses de budgets verts, ce qui souligne l’importance de sensibiliser et de former les acteurs locaux à ces enjeux.
Cependant, malgré les progrès réalisés, des limites persistent. Les méthodologies d’évaluation environnementale sont souvent critiquées pour leur incapacité à objectiver l’impact réel des dépenses, tout en ne tenant pas compte des pressions exercées sur la biodiversité par certaines activités. Par exemple, une petite dépense peut avoir un impact significatif, à l’inverse d’une dépense plus importante qui pourrait passer inaperçue. Cette lacune réduit la capacité des décideurs à faire des arbitrages éclairés. En parallèle, le manque d’un cadre technique opérationnel pour l’évaluation des dépenses nuit à la comparaison et à la hiérarchisation des enjeux environnementaux parmi les différents territoires. De plus, la diversité des approches méthodologiques rend difficile l’établissement d’un langage commun entre collectivités.
Pour surmonter ces défis, il serait bénéfique d’adopter des outils tels que la mesure d’empreinte biodiversité, qui utilise des indicateurs quantifiables pour évaluer les impacts écologiques associés aux investissements réalisables. Par ailleurs, la création de systèmes d’arbitrage permettant de classer les enjeux environnementaux selon leur priorité pourrait faciliter les décisions en matière de budget vert. Cela pourrait également impliquer une intégration systématique de la dimension écologique dans les processus de planification à tous les niveaux décisionnels. En effet, des investissements éclairés et basés sur des critères biophysiques peuvent ouvrir de nouvelles perspectives pour la transition écologique, en rendant les projets de développement durable à la fois viables et respectueux de la nature.
Il est également essentiel d’améliorer la communication autour des budgets verts, en tenant compte des préoccupations des citoyens et des partenaires financiers, afin d’assurer une mobilisation adéquate et efficace des ressources. Des études comparatives sur les impacts écologiques des décisions budgétaires pourraient également fournir des données essentielles pour renforcer la cohérence des politiques publiques face aux défis environnementaux actuels, tout en préservant les dimensions sociales et économiques de ces projets.
Budgets verts : défis et avenues pour la biodiversité
Un modèle de co-construction
Une évaluation environnementale des budgets permet de mesurer les impacts des dépenses sur l’environnement, notamment leur contribution à l’atténuation du changement climatique et à la préservation de la biodiversité. Les résultats issus de ces évaluations fournissent des outils d’aide à la décision, reliant les dépenses aux objectifs environnementaux préalablement définis.
La France se distingue comme un pionnier sur ce sujet, ayant lancé en 2019 son premier « budget vert » à l’échelle de l’État. Ce projet mondial a permis de réaliser une analyse de la compatibilité du budget national avec les cibles environnementales, créant ainsi un lien direct entre les dépenses publiques, qu’elles soient budgétaires ou fiscales, et le cadre de la taxonomie européenne.
Le rôle des collectivités territoriales est également crucial dans cette transition écologique, en raison de leurs compétences variées. En 2019/2020, une méthodologie d’évaluation climat a été développée par I4CE pour les budgets des villes et métropoles, élargie ultérieurement aux Régions et à la biodiversité. Ce projet a impliqué plusieurs Régions et partenaires, aboutissant à un système de catégorisation qualitative des dépenses en fonction des pressions sur la biodiversité.
- Mobilisation d’outils d’échange pour sensibiliser les élus aux enjeux environnementaux.
- Intégration de la dimension environnementale dans les directions financières.
- Fournir aux décideurs des éléments pour orienter les débats publics sur les dépenses.
- Suivi des impacts dans le temps et dans les décisions prises.
Un outil imparfait pour réorienter les flux de financements
Alors que le bilan des budgets verts présente des signes encourageants, certaines limites subsistent. Les débats autour des processus de catégorisation surgissent à tous les niveaux institutionnels. En effet, l’approche qualitative rend difficile l’objectivation de l’impact des dépenses, qu’elles soient faibles ou élevées, sur les composantes biophysiques.
Le design de l’outil ne permet pas non plus de prioriser les enjeux environnementaux, ce qui complique la hiérarchisation des budgets selon le contexte territorial. De plus, l’absence d’un cadre technique commun rend ardues les justifications d’impact positif sur la biodiversité. Comparativement, les instruments dédiés à la lutte contre le changement climatique, comme la taxonomie européenne, offrent des références sectorielles plus robustes.
- Incapacité à objectiver la pertinence écologique des investissements réalisés.
- Complexité de comparaison des impacts, compte tenu des divers enjeux environnementaux.
- Nécessité d’un coût élevé pour la collecte de données extra-financières pour alimenter l’outil.
La mesure d’empreinte : une approche complémentaire pour définir de nouvelles trajectoires
Le budget vert est mis à profit pour évaluer les financements affectant les composantes environnementales. Si cet outil sensibilise à l’intégration des enjeux écologiques dans les décisions budgétaires, il présente également des limites quant à la quantification des impacts.
Une approche complémentaire s’avère nécessaire pour :
- Comparer les impacts des investissements sur une base uniforme.
- Mettre en perspective les investissements avec des objectifs environnementaux quantifiés.
- Faciliter la réorientation des budgets selon des seuils d’impact fixés.
Les collectivités doivent être dotées d’outils axés sur l’efficacité écologique des dépenses, afin de piloter leurs stratégies environnementales tout en conservant leurs missions sociales et économiques. L’association des résultats de ces outils avec d’autres bilans, comme les bilans carbones, peut fournir une perspective plus globale sur les impacts des décisions financières.

Budgets verts : enjeux et perspectives pour la biodiversité
Les budgets verts représentent un outil décisif dans la transition écologique, offrant une évaluation environnementale des dépenses publiques afin de mesurer leur impact sur l’environnement. Dans ce cadre, la France se positionne comme un pionnier par l’implémentation d’un budget vert en 2019, intégrant des objectifs environnementaux au sein des dépenses. L’importance de cette approche repose non seulement sur la responsabilité de l’État, mais également sur le rôle crucial des collectivités territoriales, qui, grâce à des méthodologies appropriées, peuvent influer sur les décisions budgétaires au niveau local.
D’un côté, l’évaluation des budgets permet d’accroître la sensibilisation des élus aux enjeux environnementaux, promouvant ainsi une intégration plus profonde des dimensions écologiques à tous les niveaux de décision. Mais d’un autre côté, des limites demeurent, notamment sur la capacité des outils d’évaluation à quantifier l’impact réel des dépenses et à hiérarchiser les enjeux environnementaux en lien avec les spécificités territoriales.
Les méthodologies d’évaluation actuelles doivent être enrichies pour renforcer la transparence et l’objectivité des décisions prises par les acteurs publics. En parallèle, la capacité à justifier les impacts des budgets liés à la biodiversité et à utiliser des instruments tels que la mesure d’empreinte biodiversité pourrait se révéler essentielle pour établir des référentiels comparables et opposables. Celle-ci aiderait aussi à orienter les débats publics autour des enjeux écologiques sans les déconnecter des considérations sociales et économiques.
Au final, la mise en œuvre d’outils visant à améliorer l’impact environnemental des décisions financières est indispensable pour établir une cohérence dans les choix d’investissement. Cela permettrait de faire face aux nombreux défis actuels tout en promouvant une approche intégrée des politiques publiques sur les enjeux environnementaux. Les collectivités, en réalisant des budgets verts, pourront ainsi rivaliser sur le terrain de l’économie durable et de la préservation des ressources. L’évaluation croisée des impacts des investissements à l’aide d’indicateurs pertinents constituera une avancée significative en matière de gestion durable.
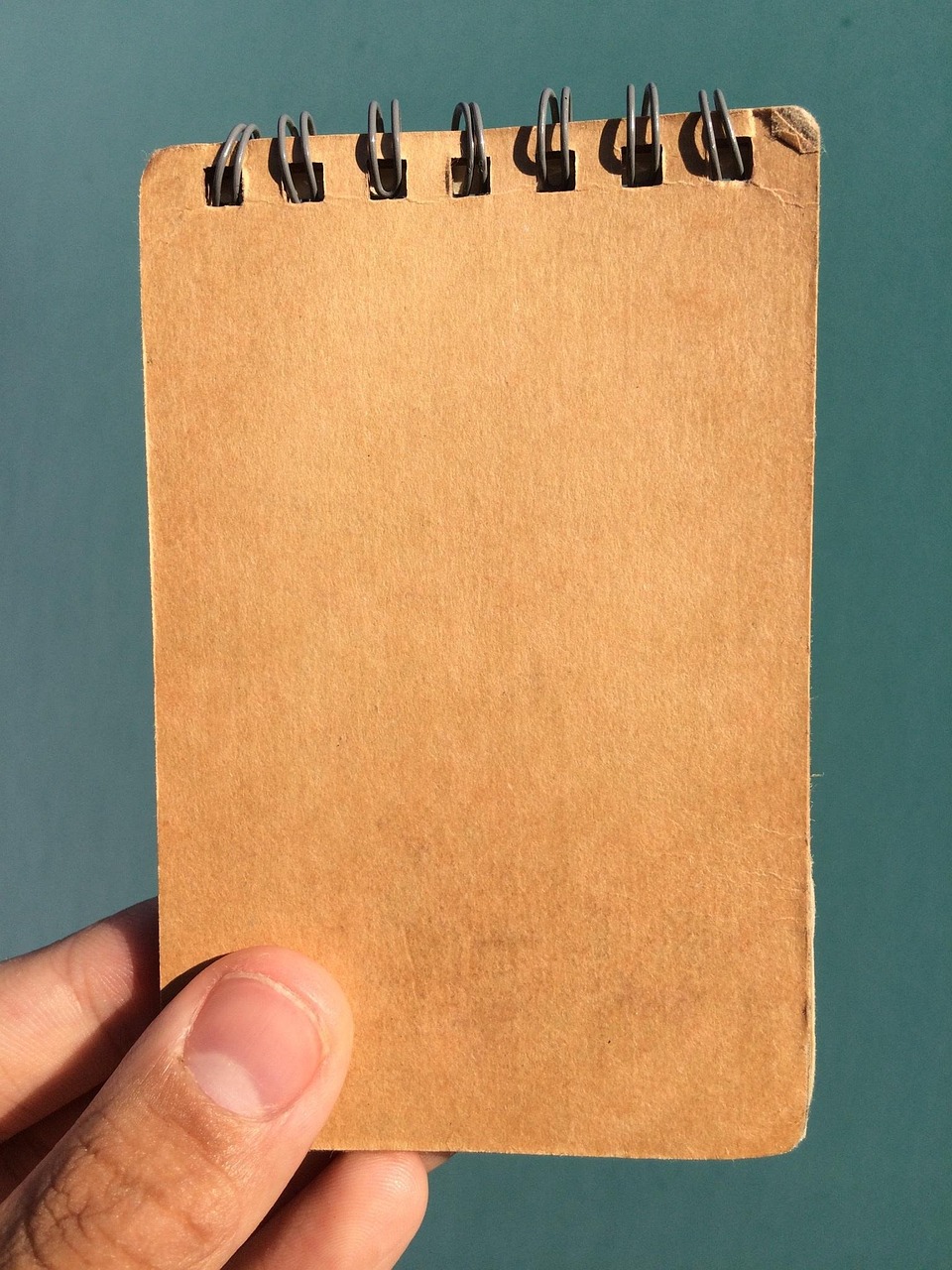
Un modèle de co-construction
Une évaluation environnementale du budget permet de qualifier l’ensemble des dépenses en fonction de leurs impacts sur l’environnement, en particulier sur leur capacité d’atténuation du changement climatique et de frein à l’érosion de la biodiversité. Les résultats de cette évaluation servent d’outils pour la prise de décision, reliant dépenses et objectifs environnementaux établis au préalable.
La France se positionne comme pionnière avec l’instauration du « budget vert » en 2019, marquant une première analyse à l’échelle mondiale sur la compatibilité du budget national avec des objectifs environnementaux. Ce dispositif crée un lien entre toutes les dépenses, qu’elles soient budgétaires ou fiscales, et les cadres de la taxonomie européenne. Les collectivités territoriales, avec leurs diverses compétences, jouent également un rôle clé dans cette transition écologique.
En 2019/2020, I4CE a élaboré une méthodologie d’évaluation climatique des budgets, qui a ensuite été élargie aux Régions et au domaine de la biodiversité. Ce processus a impliqué plusieurs Régions et partenaires dans le développement des méthodologies d’évaluation des dépenses en fonction des pressions sur la biodiversité, identifiées par l’IPBES.
Les résultats des travaux réalisés montrent que ces outils favorisent des échanges pour sensibiliser les élus aux enjeux environnementaux, intègrent la dimension écologique dans les décisions financières, aident les décideurs à réorienter les dépenses, et assurent un suivi dans le temps.
En réponse à cela, l’État impose une obligation d’analyse environnementale pour toutes les collectivités de plus de 3500 habitants, s’inscrivant dans la loi du 29 décembre 2023. Cependant, malgré les avancées, des limites subsistent dans les méthodologies, telles que des débats sur la catégorisation des dépenses, rendant difficile l’évaluation objective de leur impact réel.
Un outil imparfait pour réorienter les flux de financements
Malgré les résultats encourageants, les méthodologies d’évaluation présentent des défauts. La qualité des dépenses peut varier grandement en fonction de leur montant, et l’absence de hiérarchisation des enjeux environnementaux complique davantage la pertinence du budget relatif au contexte territorial. Par conséquent, la capacité des acteurs à justifier l’impact d’une dépense sur la biodiversité demeure limitée sans un cadre technique adapté à toutes les activités.
Il est crucial d’analyser l’impact des dépenses dans un environnement où les données nécessaires manquent souvent. La méthode de catégorisation exige que les opérateurs collectent des informations extra-financières, créant ainsi un coût significatif avec un potentiel d’impact limité.
En parallèle, les résultats d’une collectivité ne sont pas directement comparables avec ceux d’une autre, introduisant des sujets de discorde qui peuvent nuire à l’acceptation de l’outil.
La mesure d’empreinte : une approche complémentaire pour définir de nouvelles trajectoires
Le budget vert, en se concentrant sur le volume des financements impactant l’environnement, réussit à éveiller les consciences sur ces enjeux et à structurer un cadre commun d’arbitrages budgétaires. Toutefois, l’écart qui persiste à quantifier l’intensité des impacts souligne une lacune opérationnelle nécessaire pour les décisions financières des collectivités.
Il est devenu impératif de combiner cette réflexion avec des critères définis qui permettent de comparer l’impact écologique des investissements sur une base mesurable, et de prendre en compte les objectifs de réduction d’impact. Cela faciliterait les arbitrages en réorientant les budgets, notamment par l’exclusion de dépenses néfastes pour la biodiversité.
Le développement d’outils d’évaluation de l efficacité écologique de ces investissements se présente donc comme une nécessité pour harmoniser les stratégies des collectivités avec les engagements environnementaux, tout en préservant leur action sociale et économique. Le croisement entre les résultats des budgets verts et des bilans carbone semble révélateur d’une possibilité d’amélioration dans la gestion des impacts.
En intégrant des éléments de mesure d’empreinte biodiversité, comme le Global Biodiversity Score, les collectivités pourraient se doter d’une métrique solide pour évaluer leurs efforts en faveur de la biodiversité, tout en tenant compte de la nécessité d’un cadre méthodologique robuste.

